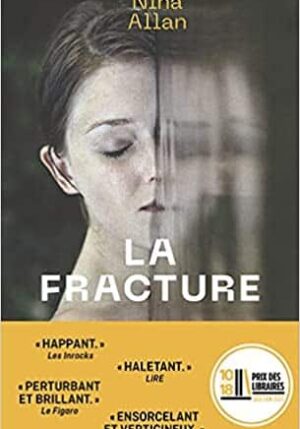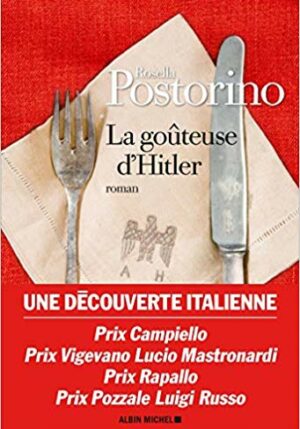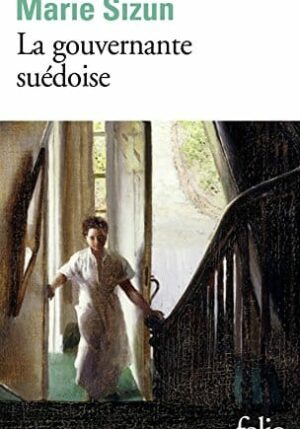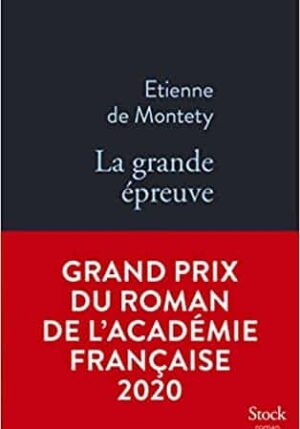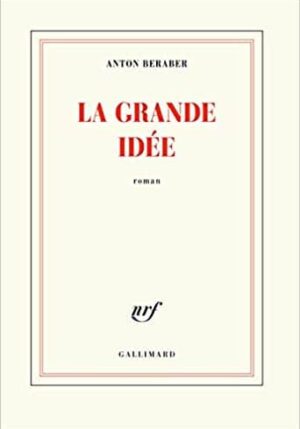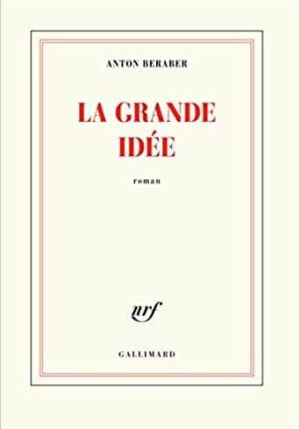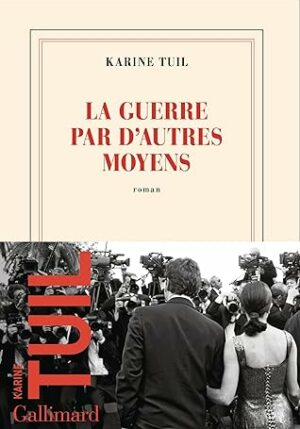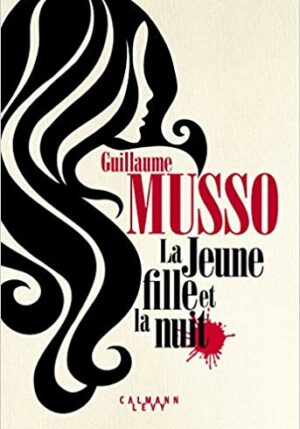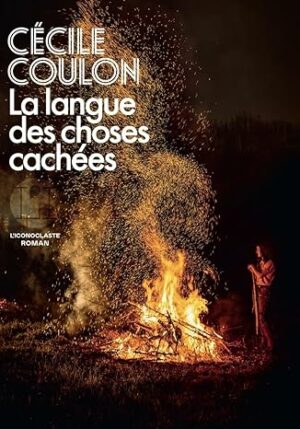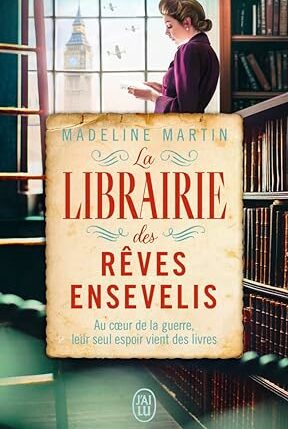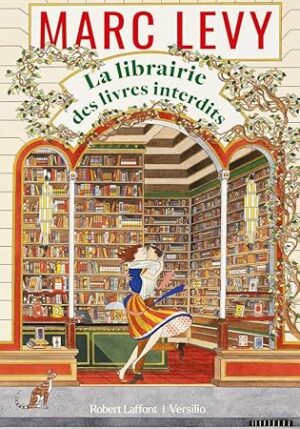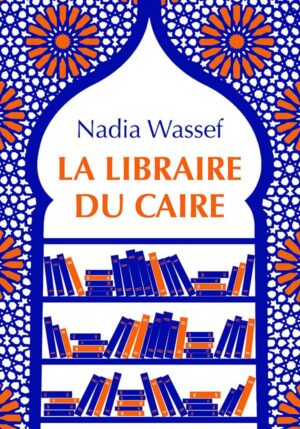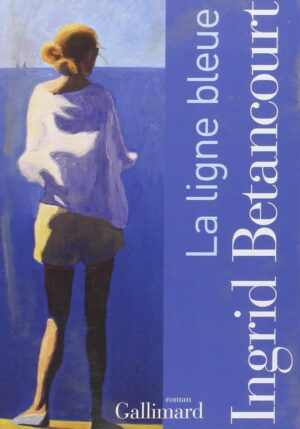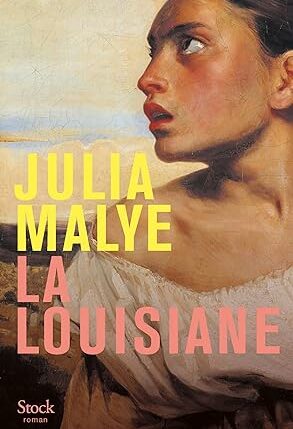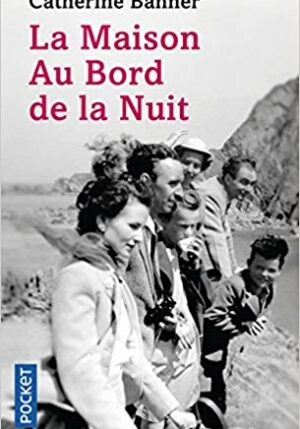La fracture (Nina Allan)
Le jour où Julie réapparaît, 20 ans après sa mystérieuse disparition, l’histoire qu’elle raconte semble impossible…
Le 16 juillet 1994 dans la région de Manchester, Julie Rouane, dix-sept ans, prétexte un rendez-vous avec une copine pour s’absenter du domicile familial… et disparaît pendant plus de vingt ans.
Longtemps après l’abandon de l’enquête par la police, son père, Raymond Rouane, continue à explorer seul toutes les pistes possibles. En vain. La mère de Julie et sa soeur cadette, Selena, tentent elles aussi de faire front, chacune à sa manière.
Puis un soir, 20 ans après, une femme qui prétend être Julie contacte Selena. Alors qu’on avait soupçonné que l’adolescente ait pu être enlevée et assassinée – un homme de la région ayant avoué plusieurs meurtres de femmes -, l’histoire que Julie raconte à sa sœur est tout à fait différente, extravagante, impossible…